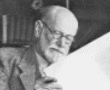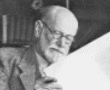"J'ai la honte"
est une expression argotique familière des jeunes de banlieue
d'une certaine façon s'oppose à une expression plus familière
comme «je suis honteux» ou plus simplement «j'ai honte. La
clinique et les institutions de soins comme les équipements
socio culturels peuvent- elles nous éclairer à mieux
comprendre, distinguer, dépasser ce signifiant familier?
Le sentiment de
honte a deux versants: psychologique et social. En effet, j'ai
la honte témoigne d'un état extérieur, partageable qu'on
endosse, qu’on subit, qui vous habite malgré vous, à l'instar
d’une maladie à laquelle on ne peut échapper! Il s’agirait
d’une prise ou une emprise dont on serait prisonnier, otage. A
l’inverse être honteux est un vécu, un sentiment, la prise de
conscience d’une situation inconfortable, qui nous a échappé,
dont on paye le prix et qui demande réparation.
Quelques vignettes cliniques pour tenter d’illustrer ces deux
dimensions:
- Un
étudiant de 21 ans que j’ai connu à la faveur d’une bouffée
délirante où il se prenait pour le diable et avait une
impression d’hostilité ambiante; sorti de cet état productif,
il est actuellement conscient de ce qui lui est arrivé. Il se
rend compte avec lucidité et sur un versant dépressif de ses
difficultés en particulier sur le plan des relations sociales.
Il est arrivé catastrophé à sa dernière séance: «je ne
commande plus à ma bouche qui dit des choses qui m’échappent.
Cette prise de conscience que «ça parle» malgré lui, lui est
très pénible, il se dit honteux. Il en profite pour me dire-
au téléphone- qu’à trois reprises il m’aurait menti dans la
dernière année reconnaissant douloureusement dans cet aveu de
la distortion de son rapport à la vérité.
-Une
psychothérapie d’inspiration psychanalytique en, face à face
s’enlise et tourne en rond, me donnant également l’impression
de m’ennuyer. Je sens un blocage qui fait barrage à la règle
du «tout dire» J’en fait part à ma patiente qui fait également
le même constat. Je lui propose alors, en tenant compte de son
refus de s’allonger, à un «truc» que m’a appris Françoise
Dolto pour débloquer une situation figée. Je demande à la
patiente de retourner son siège pour échapper au face à face
inhibiteur. Ce qui fut fait. La patiente s’effondre en
évoquant des attouchements subis à l’age de 10 ans par un ami
de la famille, dont elle se sent encore jusqu’à ce jour- où
elle est mère de 3enfants – blessée, souillée et honteuse. Ce
vécu traumatique- chez une catholique pratiquante, lui aurait
caché sa vie de couple et l’accès à tout plaisir sexuel. Tout
se passe, dans cette situation douloureuse comme si d’être
exposée au regard du thérapeute sans protection dévoilait sa
nudité comme au temps des attouchements. D’où embarras,
gaucherie, inhibition, timidité, honte et humiliation. Son
narcissisme blessé, comme son estime de soi contribuent au
sentiment de honte, d’être différente marquée d’une tare
indélébile.
-
Une conduite d’échec dans ses relations amoureuses amènent
Madame B à consulter. Lui faisant observer que ses divers
partenaires sont toujours des collègues de travail, elle
confesse en larmes avoir été abusée par son frère et qu’elle
n’en a jamais rien dit «pour ne pas lui nuire.Elle continuait
à être prisonnière d’un processus de répétition d’une relation
incestueuse ici dans le milieu du travail. Sa honte masochique
et la perte de l’estime de soi l’amènent à vivre avec un
collègue de bureau ayant lui-même une relation «platonique»
avec une autre collègue du même bureau!
-
Lors d’un premier entretien avec un homme jeune, nous lui
demandons s’il peut nous raconter un rêve récent. Il nous
évoque un ascenseur sans pouvoir en dire plus. Je lui demande
naïvement qu’en est-il de ses relations avec sa sœur?
Embarrassé, rougissant ne sachant où se mettre, il dit que les
liens sont distendus depuis qu’adolescent il avait abusé
d’elle!
- Un
homme d’age mûr consulte car il est violent avec ses
collaboratrices de travail comme avec son épouse sans pouvoir
maîtriser ses pulsions agressives. Cela reste verbale mais il
a peur d’un passage à l’acte caractérisé. Il nous apprend
avoir été abandonné par sa mère et adopté par une famille
française métropolitaine lui même étant de couleur. Cette
différence de teint avec ses parents adoptifs a toujours été
un objet d’embarras l’amenant à en vouloir à sa mère de
l’avoir abandonné et sa mère adoptive de l’avoir recueilli. La
différence de peau ne pouvant confirmer une filiation. Je lui
ai fait remarquer qu’après tout sa mère qui aurait pu avorter
a du beaucoup l’aimer pour mener sa grossesse à bon port
malgré probablement ce qu’il lui en a coûté, d’accoucher d’un
enfant vivant et d’en faire don à une famille qui lui
donnerait probablement une meilleure vie! La honte d’avoir été
«abandonné» colle à la peau, devient une cicatrice indélébbile
inconsiemment reprochée à toute femme
S’attaquer à la honte
Est-il possible de façon non conflictuelle d’être
psychanalyste, quand on assume des fonctions de psychiatre
communautaire travaillant dans le service public, ayant
également une responsabilité dans la prévention et la
promotion de la santé mentale? Habitué à travailler au «un
pour un», le passage au collectif n’est pas toujours aisé.
Peut-on, en communauté, s’attaquer au versant social de la
honte? Trois expériences nous aideront à en témoigner dans le
cadre de nos ancienne responsabilité en qualité de Chef de
Service et de Secteur des Hopitaux de Saint Denis(France).
Situé en Seine Saint Denis, département du Nord de Paris à
fort taux d’immigration, qui cumule les handicaps sociaux et
culturels avec plus fort taux de chômage, d’assistés, mais
aussi d’échec scolaire, de violence chez les jeunes de la
région Ile de France.
Devant la désertification des consultations
hospitalières destinées aux adolescents, nous avons pris
l’initiative- en nous appuyant sur le «pouvoir d’auto-guerison»
dont parle Winnicott à leu propos- d’aller à leur rencontre;
en ouvrant en ville un lieu d’accueil indifférencié, dans le
temps post scolaire 16h-20h pour les 10 - 20ans appelé Point
Accueil Jeunes(PAJ)
Nous recevions jusqu’à une cinquantaine de passage
par jour, autour d’un petit goûter et surtout d’activités
favorisant d’accès à la culture. Contrairement à l’habitude
dans ce type de structure disposant d’une série d’ateliers
plaqués, les activités mises en place l’était à leur
demande: musique, percussion, danse, théâtre, informatique…,
sans oublier qu’on pouvait également y faire ses devoirs
scolaires. Là encore nous nous sommes inspirés de Winnicott
qui disait dans «Jeu et réalité» que «rêver, jouer et accéder
à la culture sont les bases sur lesquelles repose
l’expérience culturelle.
Une
position sociologique pourrait considérer la population
accueillie comme étant faite de
«personnes
à risque. Notons qu’il n’y a jamais eu de violence. Bien
entendu il nous arrivait de raccompagner, quelqu’un qui
commençait à s’énerver, vers le pas de la porte en lui
recommandant de revenir, calmé le lendemain, n’étant pas ce
jour en position d’être accueilli!
Nous avons délibérément renoncé à
adopter une position clinique, pas de «consultation» ni
d’entretien individuel sur place, même si l’encadrement était
de psychanalystes et de psychologues. Il ne s’agissait pas non
plus de pathologiser ou repérer les personnes les plus
fragiles sur le plan de la santé mentale ou même de «dépister»
une quelconque maladie.
Un rapport
canadien
«analyse de
milieu en santé mentale: problématique et éléments de
méthodologie» insiste de façon caricaturale sur
«l'importance des problèmes associés à la santé mentale: un
indice de détresse psychologique élevé (ensemble de symptômes
spécifiques, de problèmes psychologiques), près de 8 % d'entre
eux ont des troubles mentaux et environ 4 % ont eu des idées
suicidaires au cours des douze derniers mois. En effet nous
observions des «moments» dépressifs voir même psychotique mais
sans lendemain. Nous n’avions pas non plus la posture
statistique qui cherche à démontrer que« les personnes très
défavorisées présentent un indice de détresse psychologique
deux fois plus élevé que les personnes favorisées» (30 %
versus 16.2 % ; Lavoie, 1989).
Nous ne savions
rien d’eux que ce qu’ils voulaient bien nous dire sans les
questionner, pas même leur identité! Ce n’était qu’après une
longue mise en confiance que des questions de mauvais
traitements ou de relations avec le juge des enfants pouvaient
se dire. Certains pouvaient se risquer à confesser «un plus
faible niveau de scolarité, un échec en français ou en math,
voire une grande même une grande pauvreté. Ce qui nous
intéressait c’était de rencontrer, non un problème, mais un
sujet dans le groupe quelque soit ses problèmes dont il avait
«la honte»qui le singularisait lui donnant l’impression
«d’être pas comme les autres. Il s’agissait bien au contraire
«de dé stigmatiser», «dé fataliser» de façon dynamique ces
situations.
Ce n’était pas «la
pauvreté sous sa forme économique culturelle et sociale,
(Bourdieu, 1979) qui nous intéressait, fut-elle ici un
puissant facteur de détermination de la santé, psychologique.
Il ne s’agissait pas plus d’avoir un regard invalidant,
disqualifiant de ces porteurs de «tares sociales»qui ne ferait
qu’accroître leu honte par rapport à d’autres jeunes de
milieux différents.
Paradoxalement, le
sentiment subjectif d'infériorité une conscience identitaire
négative, la mésestime de soi et des siens nous paraissaient
davantage en rapport avec un vécu traumatique, entraînant
parfois une inhibition intellectuelle ou même un court circuit
par le passage à l’acte.
On constatait au terme
d’une fréquentation - quasi quotidienne pour certains - de ce
lieu des changements de position se soldant par la «honte
d’avoir eu «honte de soi», de sa famille et de la culpabilité
qui en résulte.
C’est parce qu’il
ne s’agissait donc pas identifier les porteurs de risque en
santé mentale contribuant accroître leur détresse
psychologique. Notre but était tous simplement de prendre
plaisir à se rencontrer, papauter et passer un bon moment
ensemble.
Il est intéressant
de constater que ce n’est qu’au bout de 5 à 6 ans de
fonctionnement que certains jeunes, dépassant la honte
initiale, osaient demander pour eux- même la possibilité de
rencontrer individuellement un thérapeute pour une aide
personnalisée et qu’une consultation a ouvert dans un local
attenat, ayant un entrée différente.
Améliorer la
qualité d’un tissu social respectueux du sujet, mettre en
place des réseaux de soutien et d'entraide «culturelle», bref
créer du lien social fiable, prendre appui sur la puissance
des solidarités «ludiques»où l’on se sente en sécurité
permettent un au-delà de la honte, qui s’apparente ici par les
conduites d’évitement qu’elle engendre, à un mécanisme
phobique. Ainsi pourraient être dépassés les effets cumulatifs
du stress et des traumatismes en rapport avec des conditions
d'existence difficiles tout en favorisant l’aptitude au
changement. «Contribuer un sentiment de sécurité et d'amour,
donne à l'individu l'impression d'être estimé» est d’une aide
appréciable (Kirsh, 1983). Bref, le rôle de soutien social du
groupe est considérable puisqu'il joue à la fois sur plusieurs
aspects contribuant à la construction de la personnalité: le
maintien de l'estime de soi, le sentiment de maîtrise des
événements stressants, le développement de modèles et de
stratégies d'adaptation à l'environnement.
Le PAJ entretenait
un sentiment d'appartenance à un milieu de vie développant de
nouvelles solidarités. Il était intéressant de constater
lorsque des parents venaient au PAJ, il y avait une solidarité
adolescente qui formait groupe contre lez adultes qui
empiétaient sur leur territoire.
Jouer sur les
déterminants non sanitaires de la santé ici psycho sociaux,
permettait avec un transfert massif sur l’institution
d’améliorer considérablement leur santé mentale. Le «j’ai la
honte» devenait la base d’une solidarité: «j’ai la honte pour
l’autre» avec une fièreté de l’implication que cela
impliquait. Offrir à l’extérieur du PAJ un spectacle
contribuait à affermir le sentiment d’appartenance et de
s’autoriser à inviter d’autres jeunes ç y participer. Le
soutien du groupe permettait donc de dépasser la honte pour
affermir le bonheur d’être soi comme de l’estime de soi.
Quitter les rives de la mélancolie et de la pulsion de mort
rencontrée dans «la honte» permet de retrouver son énergie
combattive.
La honte en situation.
Nous avons
constaté ce retournement dans deux autres situations
apparemment dissemblables et cependant proches rencontrées sur
le terrain: le décrochage scolaire et la dépression post
natale.
Le décrochage
scolaire est fréquent sous nos climats. Il s’agit d’un
évitement scolaire qui se termine en rupture. Parfois quelques
années après un jeune re motivé, est prêt à parfaire une
scolarité interrompue, combler ses lacunes pour avoir une
place au soleil. C’est ainsi qu’est né «l’auto-école», une
«école de la deuxième chance», dispositif de rattrapage qui
dure un an, plus rarement deux ans destinées à l’aide des
nouvelles technologies, au rattrapage en petit groupe avec un
enseignement adapté aux besoins des élèves.
Ceux-ci avec leurs
maître étaient reçu, en dehors des heures d’ouverture
habituelles au PAJ. Maître et élèves participaient ensemble à
des ateliers de créativité; soumis aux même difficultés et
exigences dans la confrontation au réel de la matière. Cette
proximité rapprochait en créant un liant supplémentaire
permettant de dépasser la honte de la situation du retour à
l’école à l’age où on la quitte. La honte liée au déplaisir de
cette situation, pudeur et sens de l’honneur pouvaient être
alors dépassées. Il n’y avait plus de maître ou d’élève mais
des sujets cherchant ensembles à dépasser les difficultés de
la création. La traversée de la honte n’était plus liée à un
imaginaire encombrant!
Donner naissance à
un enfant est certainement l’acte humain le plus émouvant qui
procure généralement beaucoup et de satisfactions. Cependant
dans certaines situations 15 à 20 % des cas, enfanter est
totalement dépourvu de plaisir, au contraire peut même plonger
dans la détresse et la souffrance. Peut-on dans nos sociétés
assumer - sans paraître contre nature, ni bousculer les normes
et les idées reçues, dire sa peine dans une telle situation
parfaitement dépourvue de toute joie?
Il convient ici de
rappeler que si la dépression du post partum s’amende même si
l’on ne fait rien en 12 à 18mois, ses effets sur l’enfant
risquent d’être indélébiles. Ici la honte touche à un tabou
social celui de l’engendrement, la transmission de la vie au
risque d’être «une mauvaise mère»! On ne peut confesser
publiquement une telle déficience, une telle humiliation, à
ceux qui vous félicitent et vous couvrent de cadeaux! Révéler
un tel secret, être hors normes, se sentir coupable
contribuent à l’humiliation! La honte touche ici à l’idéal du
moi et au moi idéal.
Nous avons été
contacté, à l’Unité d’Accueil Mère Enfant des Hopitaux de
Saint Denis, par un groupe de «nouvelles mères» qui, à la
faveur du départ en congé de maternité de la psychologue qui
animait la protection maternelle et infantile de proximité,
sont venus nous trouver pour demander à être reçu à cet
Hopital de Jour maman – bébé en refusant toutefois de
rencontrer un médecin comme c’est la règle en milieu
hospitalier! Malgré la paradoxalité d’une telle demande nous
avons accepté de les convier à prendre le thé(open tea de nos
collègues anglais) tous les jeudis après midi. Le soin
institutionnel repose sur deux temps un accueil de groupe
encadré par des infirmières, puéricultrices et psychologues et
un entretien individuel assuré par un psychanalyste. La honte
d’avoir à confesser la douleur d’être mère et se reconnaître
en souffrance se manifestait par un refus de rencontrer un
thérapeute. Bien entendu les psycho pathologies rencontrées
dans ce groupe étaient similaires à celle des mères que la
reconnaissaient de cette souffrance n’humiliait pas!
Ici comme chez
les adolescents on se heurte au même refus actif de soins qui
vient pour camoufler une blessure narcissique occasionnée par
la honte de ne pas se suffire à soi même. La reconnaissance de
la souffrance, vécue comme une humiliation est vigoureusement
refusée à ces ages de la vie! En effet adolescence et post
partum sont des moments de remaniement identitaire, de
passage, de rupture et de deuil, avec les objets du passé.
Moment de modifications anatomique et physiologique qui
participent delà transformation du sentiment d’identité et
d’identification. D’où l’importance lors de cette traversée
des «contenants» au sens de Bion à mettre en place pour
absorber l’assaut pulsionnel comme les modifications
énergétiques et structurales.
La proximité
relationnelle maman – bébé et les manifestations de la
souffrance des protagonistes donne une double entrée, à la
problématique, ce qui permet de multiplier les voies d’abord.
C’est ainsi que
sont nées, dans le cadre de cet hopital de jour, en dehors
d’un après midi «maison verte», à la Françoise Dolto divers
«clubs» et consultations:« clubs de bébé», «clubs de nouvelles
mères», «club de nouveaux parents» l’intérieur service, en
maternité, ou même en ville.
Diverses
consultations ont ainsi vu le jour: «psychosomatique du
nouveau né» consacrée aux symptômes troubles du sommeil, de
l’alimentation, consultation parentale compte tenu des
modifications de l’appétit sexuel mal vécu par les pères qui
en profitent pour être absent. Enfin une consultation
médiatisée par les travailleurs sociaux – les mieux acceptés
dans une famille- qui suivent des situations de détresse du
post partum chez des sujets qui refusent tout accès autre aux
soins. L’offre d’accompagnement, «l’aide à être aidant»
proposées aux travailleurs sociaux comme support d’étayage
permet d’éviter des passages à l’acte intempestifs comme
l’hospitalisation à tous prix ou le retrait de l’enfant quand
ils ont l’impression que celui-ci peut-être en danger!
Un constat ici
s’impose c’est la fréquente opposition des nouveaux pères
d’accepter que leur femme soit «malade» opinion partagée
parfois même par le médecin de famille qui rationalise, quand
il ne banalise pas, les «fatigues bien compréhensibles qui
suivent un accouchement. La «maladie» –qui échappe au sujet-
est ici vécue comme «étrangère à soi»; comme « un exil de
soi» qui ne peut être reconnue ? La honte qui traduit l’échec
du processus de reconnaissance en fait une situation
réfractaire au désir de soin, comme à la ré appropriation de
son histoire.
Honte, sentiment
d’infériorité et estime de soi- sur le plan collectif comme
individuel - nous confrontent aux aléas du narcissisme
infantile de chaque sujet, vécu de castration qui peut
entraver ses réalisations intellectuelles et sociales comme sa
représentation de soi entraînant la perte de l’estime de soi.
Qu’en est-il alors
quand cette fluctuation imaginaire du sentiment d’identité
rencontre, dans le réel des conditions extérieurs-
traumatiques, cumulatives ou intergénérationnelles -
défavorables pouvant entraîner régression désorganisante et
perte de soi? La fréquence de survenue de ces conflits de
maturation en fait un problème de santé publique en
particulier lors du combat de l’adolescence ou de l’accès à la
maternalité.

|